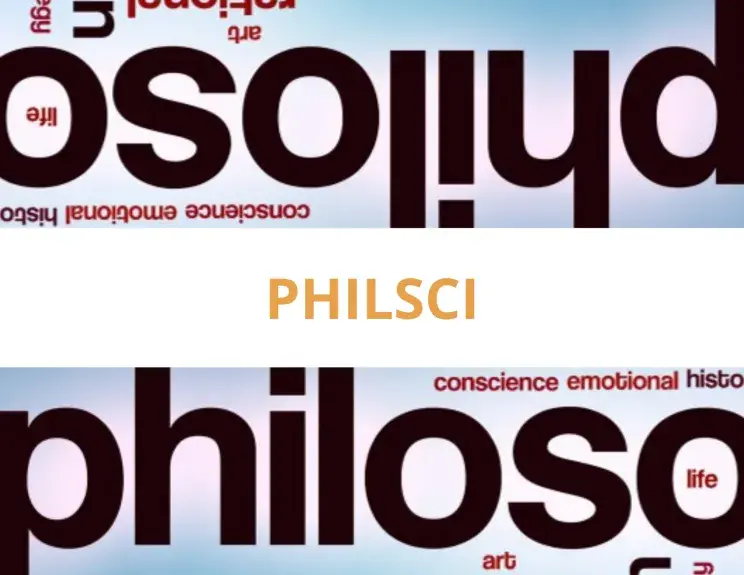
Séminaire PhilSci
Nous aurons le plaisir d'écouter :
Ana Carolina Fiuza (Nouvelle Université de Lisbonne (NOVA))
Titre : « La crise de la métaphysique et la technique en tant que paradigme ontologique »
Résumé : Dans ce que l’on appelle la Modernité, une crise permanente de la métaphysique se manifeste, diagnostiquée sous différentes perspectives: comme crise des sciences (Edmund Husserl), crise de l’esprit (Paul Valéry), crise de la théodicée chrétienne (Hans Blumenberg), la remise en question du cercle corrélationnel et de ses limites inhérentes (Quentin Meillassoux), ou encore comme une spéculation sur une possible fin de la métaphysique (Gérard Lebrun). À partir de cette notion de crise, il s’agit d’interroger le rôle de la technique, non pas comme un simple phénomène adjoint, mais comme un élément central permettant de comprendre ce processus. La technique, entendue comme un domaine explorant la production et les modes d’existence des objets — et, pourquoi pas, des sujets? —, peut être comprise simultanément comme cause, conséquence, approfondissement, voire solution à la dite crise.
Dans cette perspective, il convient d’articuler deux régimes de pensée: l’un centré sur la raison et le suprasensible; l’autre, qui semble à première vue, renvoyer à la matérialité du monde. Ces régimes s’opposent-ils ou se complètent-ils d’une certaine manière? Pourrait-on affirmer que la crise de la métaphysique ouvre la voie à la légitimation ou à l’émergence d’une "phase technique"? Si tel est le cas, dans quelle mesure celle-ci doit-elle être comprise comme un résultat direct de la crise ou comme un autre référentiel ontologique?
Ces réflexions conduisent à envisager la possibilité d’une nouvelle ontologie de la matière, qui ne se limite pas à reformuler les relations entre les sujets et les objets techniques, mais qui reconfigure également le champ même des études ontologiques. Cette approche s’inscrit dans l’idée d’une matériologie (François Dagognet), qui réhabilite la matérialité comme domaine d’investigation et met en avant la "richesse de la matière" (Gaston Bachelard), envisagée comme une instance chargée d’énergie, en perpétuelle transformation et réorganisation. La technique, transfigurée dans les machines et les objets techniques, apparaît alors comme un mode d’accès et de connaissance de cette réalité, un moyen de donner une expression à la matière. Parallèlement, l’individuation de l’être (Gilbert Simondon), dans sa relation à celle des objets techniques, suggère que la technique peut être pensée comme porteuse d’une ontologie propre. Peut-on alors parler d’une "technicité originaire", d’une anthropogenèse imbriquée dans la technogenèse, comme fondement d’une ontologie — ouverte — de l’être? On considère que, en créant de nouvelles articulations entre le sujet, l’objet et le monde, la technique rouvre des questions ontologiques, les déplaçant vers un terrain matériel, techniquement médié et en constante reconfiguration – revêtant ainsi la métaphysique elle-même d’un nouveau paradigme.
Lien Zoom pour ceux et celles qui ne pourraient pas être présents :
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/93763324116?pwd=2quXn7biob5EXC4W5LREIJZfbSWOK8.1